« Les moindres plaisirs… »
Préface au Flâneur des deux rives de Guillaume Apollinaire
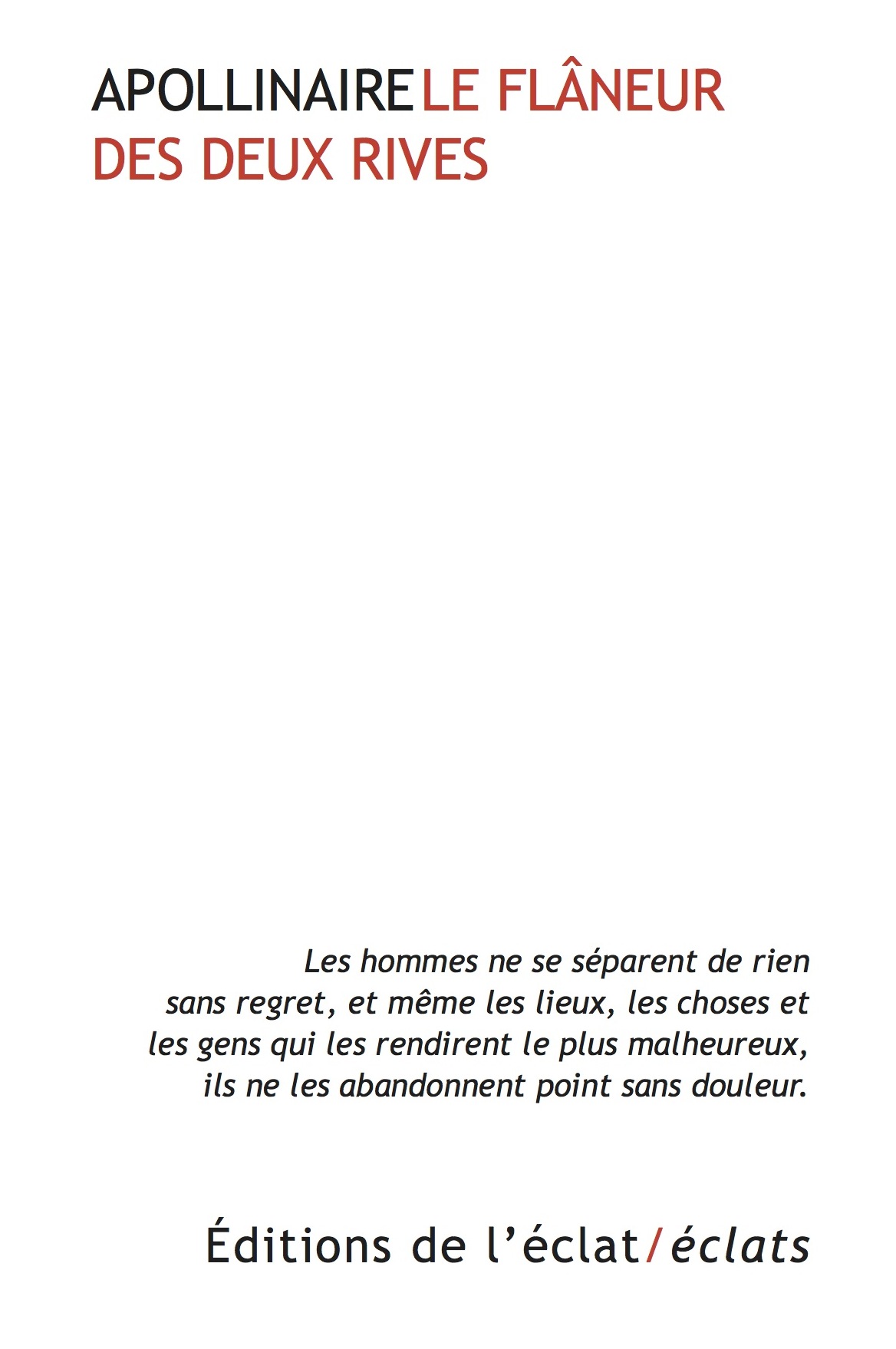
« Pour le parfait flâneur, c’est une immense jouissance que d’élire domicile dans le nombre, dans l’ondoyant, dans le mouvement, dans le fugitif et l’infini. Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux… » Baudelaire, 1863
De toi, Guillaume, je croyais avoir tout lu. Et il est certain que tu ne sortiras pas du tombeau pour reprendre tes rimes. Tu m’as fait tant rire et pleurer que j’en ai les yeux tout étriqués. C’est ainsi que dans ma flânerie nostalgique je tombai sur Le flâneur des deux rives, ou sur ce que tu en dis et qui n’est pas de chair et d’os, mais d’eau grise et de bitume. Un triple fleuve aux eaux noires donc. Le berceau d’encre où tous nous laissâmes quelques plumes. Les îles effilochées de nos adolescences perdues. Une trilogie d’eau et d’asphalte qui berça nos enfances de troubles mystères. Parcours de nos vies. Nous y apprîmes à marcher, à courir, à aimer et à nous rebeller. Y compris contre nos amours, qui ne furent ni plus belles ni plus heureuses que les tiennes.
Et l’on ne s’éloigne jamais autant que l’on voudrait des choses et des lieux du passé. Ils encombrent le présent de tout un tas d’émotions et d’images qui altèrent sans fin l’enchantement des choses nouvelles. Même la mort, cette inflexible désenchanteresse qui teinte de couleurs morbides nos plus beaux souvenirs, ne parvient pas à rompre le sortilège. Et s’il est un lieu de ma mémoire hantée qui me hante et auquel je reviens toujours en rêve, comme en promenade, c’est la Seine. La Seine à Paris. Est-ce parce que ce nom théâtral emporte vers l’océan nos illusions d’enfants à capitales?
Enfants nés entre les brouillards et les tournants des siècles, nous avons appris à marcher sur des pavés inégaux. Aussi inégaux que nos classes sociales et nos conditions de logement, comme on disait encore alors. Funambules sans rire au fil de son eau sombre, charriant embarcations et suicidés, nous avons appris aussi, à grand renfort de ricanements et de zézaiements, le plus beau poème que l’on écrivit sur un fleuve. Que serait la Seine, si le troupeau bêlant de ses ponts n’était gardé par une bergère Tour Eiffel? Que serait Paris sans Ernest La Jeunesse, sans sa folie et ses empilements de livres et d’objets hétéroclites? L’antre de La Jeunesse, tel que tu le décris, indique, à la manière des maquettes de la préhistoire, ce que fut l’habitat parisien le plus authentique, avant que l’authenticité, justement, ne soit revisitée, non par le maquettisme, mais par le marketing. Dont la dernière syllabe, reprise en écho à l’infini, fait sonner la nouvelle rengaine parisienne. Ting ting, bruit de tiroir-caisse sécurisé, dont le même Ernest se serait étonné avec la constance qui était la sienne et celle de tous les Earnest entre les deux rives, lui qui, moquant la vanité des écrivains patentés dans L’assiette au beurre, les appelait « Les Tumalu? ». Parions qu’aujourd’hui il aurait fort à faire. Mais c’est là un pari perdu d’avance car les La Jeunesse ont vieilli sous la coupole et comment se moqueraient-ils d’eux-mêmes?
Oui, nous étions cela. Cette pauvreté griffée de poésie et de sagesse. Sagesse de savoir que rien de ce qui nous importe ne s’achète. Et que tout ce qui s’achète ne devrait pas nous importer. Même la couleur ne nous importait que bien peu, une tache par-ci par-là, le rouge du kil d’un clochard éméché, le vert des yeux d’une fille joyeuse, la lueur du Point-du-Jour où « Lili d’Auteuil aima Totor » comme tu l’écrivis à ton tour, Guillaume, rajoutant un grain de poésie là où il n’y avait qu’un mur de pierres sèches. Mais si la couleur ne nous importait que bien peu, c’est que comme toi et comme tous, nous étions aussi les enfants d’un noir et blanc argentique. Nous, désargentés enfants d’après la Seconde Guerre, espérant encore qu’elle ne sera pas la Deuxième et que notre superstition grammaticale saura nous préserver du pire. Elle n’a pourtant pas épargné Paris, et le déluge de couleurs et le flot d’argent qui ont coulé le long de ses rives pourraient faire dire au poète revenant: où es-tu la ville? où sont tes flâneurs? quelle frénésie s’est emparée de tes rives? Toi, qui écrivais qu’aller de la gare d’Orsay au pont Saint-Michel est la plus belle promenade au monde, tu avais alors bien raison. Et si cette promenade, emportant sur son passage la lenteur des ciels et la rapidité de tes pensées, était la plus belle du monde, ce n’est ni à ses édifices ni à la douceur de ses gris tendres, ni à ses nacres d’eau laiteuse qu’elle le devait. Laissons ça aux peintres, tes amis. C’est à ses doubles fixés le long des courbes mouvantes de la Seine. Ces boîtes pleines de livres. Ajoutant un fleuve d’encre à ceux de bitume et d’eau boueuse. Et c’est là que nous apprenions à lire. Pas lettre à lettre devant le tableau noir, mais par sauts et par bonds au-dessus des précipices et des vertiges. Le tout au ralenti, bien sûr. Pourquoi se presser quand on flâne et que le temps s’est ancré dans un fleuve de papier? Des flâneurs et des flâneuses il y en avait beaucoup alors sur les deux rives, et nous aussi nous nous appelions « la jeunesse », faisant vivre à grands traits d’oisiveté et d’ubiquité nos rimes et les tiennes.
Les Halles étaient le ventre de Paris, les bouquinistes en sont l’âme. Elles se referment à la nuit comme des fleurs de fer, ces boîtes, elles s’ouvrent au jour pour libérer leurs parfums qui sont les savoirs et les déraisons. Quelques pièces dans le creux de la main, le souffle chaud d’une cigarette, mitaines et houppelandes, gants fourrés et manteaux. L’uniforme du bouquiniste a peu changé. L’été, un rien l’habille, l’hiver il se décline en couches et sous-couches comme le papier de ses trésors de trois sous. Ce n’est pas un métier d’avenir et les métiers du passé sont bons pour le musée. Il n’ira pas au Panthéon, si ce n’est celui de nos mémoires. C’est là pourtant qu’un jour d’hiver, entre une photo de Bob Dylan, dont le sourire narquois d’un Villon moderne retenait mon regard, et une collection de cartes postales érotiques qui ne t’aurait pas déplu, j’ai trouvé ce livre, Le flâneur des deux rives. Le titre m’allait comme un gant. Sur la couverture, habillée par Mario Prassinos pour la nrf, s’insinuait, dans un luxe de couleurs, une fleur vénéneuse dardant d’étranges épines. Était-ce à cause des colchiques? Qu’importe! Les voitures qui longent les rives de la Seine, envenimant le troupeau des matins à coup de gueules d’acier, empoisonnent les ponts depuis si longtemps que le flâneur, désormais, s’avance masqué sous ses paupières mauves. Tu étais las d’un monde ancien? Viens visiter ce monde sans lassitude où l’ennui moderne se paye à crédit. Nous trinquerons ensemble à nos folles jeunesses.
J’ai acheté ton livre sur la rive de la Seine, et je l’ai lu. Et que veux-tu, je mêle mes larmes aux tiennes, Guillaume, toi qui l’as écrit et qui pleurais souvent car…
... on ne s’éloigne jamais autant que l’on voudrait des choses et des lieux du passé…
